Réduction des Risques et alcoolo-dépendance
Posté par Grâce Belang 16 octobre 2025
Animée par Cyril Dupouy, Directeur du programme PHC, cette table ronde a réuni :
- Mathieu Fieulaine, Fondateur du collectif Modus Bibendi, Responsable du Centre-Ressources anthropologue
- Jean Levy, Médecin généraliste et addictologue, membre du comité de coordination du collectif Modus Bibendi
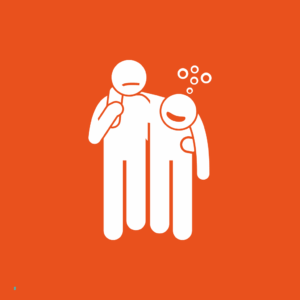
Changer de regard sur les usages de l’alcool pour mieux accompagner
Modus Bibendi est un collectif pluridisciplinaire qui réunit des professionnels du soin, du travail social, du journalisme et des sciences sociales, et qui a initié une démarche de réflexion autour de la question de la consommation d’alcool et d’un changement d’accompagnement sur ses consommateurs, basée sur la réduction des risques.
Le collectif met en avant la nécessité de reconnaître que l’alcool, majoritairement perçu comme un problème, a bien des fonctions positives pour beaucoup de consommateurs : détente, plaisir, sociabilité ou encore gestion de la douleur et du stress. Dans certains cas, retirer brutalement cette « aide » peut fragiliser la personne, voire la mettre en danger.
En contexte de précarité, les usages de l’alcool deviennent encore plus centraux. Les consommations sont souvent nécessaires pour rendre la réalité plus supportable. Les personnes consommatrices subissent alors une double stigmatisation : celle liée à la pauvreté et celle liée à la consommation d’alcool. Les interdictions de boire (dans la rue, en centre d’hébergement, sur les chantiers d’insertion) poussent parfois à boire en cachette, dans l’urgence, augmentant les risques physiques et sociaux.
Le cadre légal : ce que dit vraiment la loi
Les échanges ont permis de rappeler qu’au-delà des interdictions de consommer sur dans différents lieux et contextes, la consommation d’alcool peut être défendue par les droits fondamentaux de la personne. Elle relève de la liberté individuelle, protégée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, un niveau juridique qui s’impose aux autres niveaux d’encadrement législatif et réglementaire.
Or, il est important de rappeler que la loi n’interdit pas strictement la consommation d’alcool sur le lieu de travail, mais uniquement lorsque cette consommation met en danger autrui.
Modus bibendi rappelle d’autres principes liés à la liberté des personnes de consommer de l’alcool :
- Le respect de la vie privée : certains espaces (toilettes, casiers, chambres, salles de pause) sont considérés comme des lieux intimes. Les fouilles ou contrôles sans consentement sont donc illégaux.
- Le droit à la confidentialité : une personne n’a pas à déclarer ses consommations, même lors d’un recrutement.
- Le principe de proportionnalité : un employeur peut restreindre la consommation sur certains postes à risque (chauffeurs, machines dangereuses) mais ne peut pas l’interdire sur l’ensemble de la structure.
L’idée n’est donc pas de banaliser la consommation mais de trouver un équilibre entre sécurité et respect des libertés. L’enjeu est de distinguer les situations où la consommation met réellement en danger la personne ou les autres, de celles où elle relève d’un usage personnel.
Comprendre, réguler, inclure
Les intervenants ont insisté sur la nécessité de faire évoluer les pratiques professionnelles pour sortir d’un fonctionnement où les accompagnants décident souvent pour la personne, sans se baser sur son expertise issue de ses besoins et de son vécu. L’approche de Modus bibendi souligne le besoin d’adapter les dispositifs aux personnes, plutôt que d’exiger des personnes qu’elles rentrent dans le cadre des dispositifs, car cela est susceptible d’augmenter les risques pour elles. Interdire ou sanctionner la consommation d’alcool ne fait souvent qu’exclure davantage les personnes déjà fragiles.
À l’inverse, reconnaître les consommations comme une réponse à une souffrance permet d’ouvrir le dialogue. Cela passe par :
- La création d’espaces de parole sécurisés et bienveillants ;
- Le partage d’expériences entre salariés et encadrants (ex. : parler de sa propre consommation, organiser des temps conviviaux encadrés) ;
- Le retrait de supports de prévention culpabilisants ;
- La mise en place de temps de pause ou d’espaces sécurisés pour éviter les consommations cachées et dangereuses.
Certains exemples illustrent bien cette approche : une communauté Emmaüs a par exemple choisi de créer sa propre brasserie, transformant la consommation en projet collectif et responsabilisant.
En résumé, il s’agit remettre du sens et de la dignité dans l’accompagnement de la personne vis-à-vis de l’alcool, sans en nier les risques. La réduction des risques, dans ce contexte, vise d’abord à réinclure les personnes et à restaurer un lien de confiance, plutôt qu’à renforcer leur exclusion.
